Cédric Philibert
« Nous en sommes encore aux prémices »
Chercheur associé à l'institut français des relations internationales (IFRI)

Partout sur le globe se développent des mégaprojets autour de l’hydrogène propre. Mais l’exploiter de façon rentable s’avère encore complexe, nous explique Cédric Philibert, analyste de l’énergie et du climat.
AM : Il y a deux catégories d’hydrogène, le vert et le gris. Qu’est-ce qui les différencie ?
Cédric Philibert : L’hydrogène vert est produit par l’électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables [donc sans rejets carbonés, ndlr]. Le gris est quant à lui produit par « reformage » vapeur du gaz naturel à 800 degrés, ou par oxydation partielle du charbon. Une réaction chimique se produit : le méthane et l’eau vont produire de l’hydrogène… mais aussi du dioxyde de carbone (CO2 ). Ce processus engendre donc des rejets carbonés en tant que matières premières, en plus des rejets résultant de la combustion du gaz naturel, qui fournit son énergie au procédé. Cet hydrogène gris dégage 800 millions de tonnes de CO2 par an dans le monde ! Il faudra donc soit le décarboner – c’est ce que l’on dénomme «hydrogène bleu», fabriqué à partir d’énergie fossile, mais dont on capture le CO2 émis lors de son élaboration –, soit le remplacer par de l’hydrogène vert.
Le gris domine-t-il encore le marché ?
Le vert reste en effet pour le moment très marginal. Les gros projets demeurent théoriques. L’hydrogène connaît un regain d’intérêt depuis la COP21 [qui s’est déroulée à Paris en décembre 2015, ndlr], lorsque l’on a envisagé de se diriger vers zéro émission nette de gaz à effet de serre, supposant de diviser les émissions par quatre, six ou huit. Cela change la donne : avant 2015, on envisageait surtout de décarboner le secteur de la production électrique. Il s’agit désormais d’aller beaucoup plus loin, de décarboner l’industrie, les transports… Cela implique de remplacer l’hydrogène gris par le vert – et dans certaines situations, de l’utiliser aussi comme vecteur d’énergie. La Namibie table sur 5 GW de solaire et d’éolien, dont 2 GW d’hydrogène produit par électrolyse.
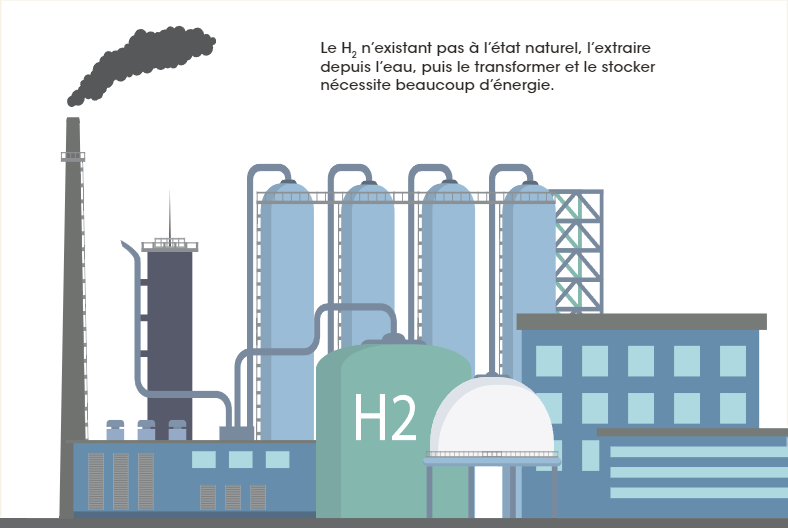
Depuis quand s’y intéresse-t-on ?
L’idée d’utiliser l’hydrogène comme énergie est ancienne ! Son parcours rappelle celui du photovoltaïque : l’idée d’utiliser l’énergie solaire remonte au début du XXe siècle – Albert Einstein avait déjà étudié la question –, mais la première cellule photovoltaïque n’est apparue qu’en 1954. Car pendant des décennies, l’énergie solaire coûtait trop cher et le processus n’était donc guère rentable – sauf en ce qui concerne des lieux trop isolés pour être raccordés au réseau électrique classique. Il a donc fallu attendre que le photovoltaïque soit subventionné par les pouvoirs publics pour que se crée, enfin, un effet d’entraînement : ces quinze dernières années, le coût du mégawattheure a été divisé par 10 ! On verra peut-être le même phénomène avec l’électrolyse productrice de dihydrogène. Mais nous en sommes encore aux prémices. L’avion à hydrogène volera en 2035… si tout va bien. À ce rythme, la flotte aérienne ne sera remplacée que vers 2050, quand la bataille contre le réchauffement climatique risque d’être déjà bien engagée.
L’hydrogène pourrait-il devenir le pétrole de demain ?
Je ne pense pas. À mon sens, il sera seulement utilisé pour les engins ne pouvant fonctionner avec des batteries électriques classiques, qui demeurent beaucoup plus efficaces. Car l’hydrogène nécessite beaucoup d’énergie pour sa compression, son transport… Il sera davantage utilisé par l’industrie. On peut l’employer pour produire des engrais azotés, raffiner les produits pétroliers, ou dans le domaine de la sidérurgie lors de la réduction du minerai de fer (afin d’en retirer l’oxygène, qui l’oxyde). Aujourd’hui, ces processus industriels sont accomplis avec du gaz ou du charbon : on pourrait les effectuer avec de l’hydrogène. Il permet également de stocker de l’électricité. En ce qui concerne les transports, on ne sait pas électrifier les tankers ou les supercontainers : les longues liaisons maritimes demeurent en effet hors de portée des batteries électriques, car elles occuperaient les trois quarts de la surface du navire ! Afin de remplacer le gazole, on recherche un combustible à base d’hydrogène, comme l’ammoniac (composé d’azote et d’hydrogène). Dans les avions, il faudrait associer l’hydrogène vert avec du carbone, et c’est pour le moment très compliqué. Mais en ce qui concerne le train, les batteries électriques feraient cela aussi bien. C’est l’élément le plus répandu sur terre. Oui, mais qu’il soit si répandu n’est pas le problème, car le dihydrogène utilisé à des fins industrielles n’existe pas à l’état naturel, ou alors seulement en petites quantités. L’extraire depuis l’eau, puis le stocker, exige beaucoup d’énergie. Cette dépense énergétique pèse fortement sur le rendement