Développement : le Ghana à l’épreuve du pétrole
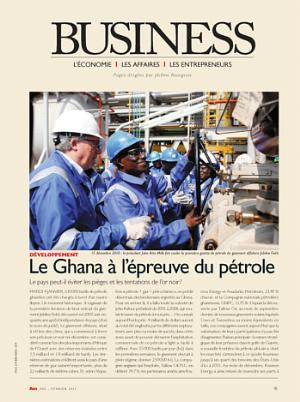
Mardi 4 janvier, 630 000 barils de pétrole ghanéen ont été chargés à bord d’un navire libyen. Un moment historique : il s’agissait de la première livraison de brut extrait du gisement Jubilee Field, découvert en 2007, soit cinquante ans après l’indépendance du pays (d’où le nom de jubilé). Le gisement offshore, situé à 60 km des côtes, qui a commencé à livrer son précieux or noir mi-décembre, est considéré comme l’un des plus importants d’Afrique de l’Ouest avec des réserves évaluées entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de barils. Les dernières estimations créditent aussi le pays d’une réserve de gaz naturel importante, plus de 22 milliards de mètres cubes. Et, selon l’équation « pétrole + gaz = pétrochimie », on prédit désormais des lendemains argentés au Ghana.
Pour en arriver là, il a fallu toute la volonté de John Kufuor, président de 2001 à 2008, qui voulait trouver du pétrole à tout prix… On connaît aujourd’hui le prix : 4 milliards de dollars auront au total été engloutis par les différents explorateurs, avec plus ou moins de succès, dans cette zone avant de pouvoir démarrer l’exploitation commerciale de ce pétrole « light », facile à raffiner. Avec 55 000 barils par jour (b/j) dans les premières semaines, le gisement devrait à plein régime donner 250 000 b/j.
La compagnie britannique qui l’exploite, Tullow Oil PLC, en détient 34,7 % ; les partenaires américains Kosmos Energy et Anadarko Petroleum, 23,49 % chacun, et la Compagnie nationale pétrolière ghanéenne, GNPC, 13,75 %. Depuis la découverte par Tullow Oil, au mois de septembre dernier, de nouveaux gisements voisins baptisés Owo et Tweneboa au moins équivalents en taille, ces compagnies savent aujourd’hui que la valorisation de leurs participations n’a pas fini d’augmenter. Raison principale : la nature stratégique de leur présence dans le golfe de Guinée, « nouvelle frontière du pétrole africain », dont les marchés s’attendent à ce qu’elle fournisse jusqu’à un quart des besoins des Etats-Unis d’ici à 2015.
Au mois de décembre, Kosmos Energy a ainsi refusé de revendre ses parts à la GNPC, qui lui en offrait, avec un joint-venture composé du chinois Cnooc, du norvégien Statoil et du britannique BP, un montant de 5 milliards de dollars, non négligeable, mais encore très loin de l’estimation de 7 milliards de dollars rendue publique au mois de septembre par le cabinet Buckingham Research Group. Vu les perspectives du Jubilee Field et de toute la zone, Kosmos, modeste compagnie comparée aux grandes majors du secteur, spécialisée dans l’exploration de zones offshore relativement oubliées dans l’ouest du continent, a donc décidé de capitaliser sur sa position plutôt que d’encaisser immédiatement les profits de ses investissements comme le fait d’habitude ce type d’opérateurs. La compagnie s’attend aussi à une surenchère des sociétés chinoises, très impliquées dans le secteur énergétique du Ghana et très gourmandes en pétrole. D’après l’agence économique Bloomberg, la Banque d’import-export de la Chine a investi plus de 10 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures ghanéens au mois de septembre dernier, pendant que la Banque de développement de la Chine prêtait 3 milliards au pays pour le développement de ses projets dans le pétrole et le gaz.
On sait que le nouveau président depuis 2009, John Atta Mills, est pressé de voir se multiplier le nombre de plates-formes pétrolières dans ses eaux. On sait moins si les membres de son gouvernement et les élites politiques et économiques du pays vont pouvoir éviter les pièges classiques posés par l’industrie du pétrole, qui portent des noms trop entendus sur le continent depuis des décennies : corruption, accaparement, enrichissement, pots-de-vin, évasion…
Au contraire, cet or noir représente-t-il une vraie chance pour les 25 millions d’habitants, dont un tiers vit encore sous le seuil de pauvreté ? Jusqu’ici, les Ghanéens tiraient leurs revenus de l’agriculture, notamment la production de cacao (deuxième producteur mondial), de l’extraction d’or (deuxième après l’Afrique du Sud) et des transferts d’argent reçus des parents expatriés. Richesse nationale : un PIB estimé à 36 milliards de dollars en 2009, 1 500 dollars par habitant, derrière le Kenya (1 600 dollars) ou la Côte d’Ivoire (1 700 dollars), dont elle est voisine. Dans un document diffusé au mois d’avril 2010, le FMI s’interrogeait déjà sur l’impact de cette nouvelle manne pouvant déstabiliser tous les autres pans de l’économie traditionnelle (le syndrome de la maladie hollandaise ou Dutch disease).
D’après le FMI, la pleine production du Jubilee Field sera atteinte d’ici à cinq ou six ans, contribuant pour 4 à 6 % du PIB. Sur la période 2012-2030, les revenus tirés du pétrole et du gaz devraient représenter 12 milliards de dollars pour le gouvernement, au rythme de 400 millions à un milliard de dollars annuels. Comment investir cette manne ? dans quels secteurs ? dans quelles conditions de transparence et de politique économique, notamment en matière d’inflation et d’emploi ? Autant de questions qui font aujourd’hui du Ghana un vrai cas d’école pour les économistes des grandes institutions et autres experts des think-tanks.
En attendant, au niveau national, la question de la « colatéralisation des revenus du pétrole » fait l’objet d’un débat parlementaire depuis plusieurs mois. Censée être adoptée à la fin de l’année 2010, la loi sur la redistribution des revenus du pétrole devait à nouveau être examinée au mois de janvier sur fond de prévision de croissance très optimiste, au moins 9 %. Raison supplémentaire pour fournir un cadre légal aux recettes du pétrole et du gaz, commentent unanimes les experts, pour qui le texte en discussion est loin d’être satisfaisant. D’après Alex Vines, du groupe de réflexion Chatham House, le principal défaut de la future loi est de proposer la création d’une agence de régulation du secteur plutôt qu’une autorité indépendante. Ainsi la GNPC ou le ministre de l’Énergie pourraient remplir à la fois les rôles de régulateur et d’opérateur, regrette le chercheur qui souligne l’importance de « dépolitiser les décisions » si l’on veut vraiment que les taxes et royalties servent à lutter contre la pauvreté.
Début janvier, à la suite d’un remaniement de gouvernement voulu par le président John Atta Mills, le nom du nouveau ministre des Ressources naturelles était l’un des rares à ne pas être connu.
Par Jérôme Bourgeois
Article paru en ouverture du cahier Business d'Afrique magazine numéro 305 (février 2011)