Feurat Alani
De Bagdad à Paris

Né en France, originaire d’Irak, grand reporter, réalisateur de documentaires, il navigue entre les frontières et vient de publier son premier roman, Je me souviens de Falloujah. Une œuvre forte sur la paternité, la mémoire, les origines.
À 43 ans, Feurat Alani mène une vie sur plusieurs fronts. Avec des origines entre la Seine et l’Euphrate (d’où son prénom). Avec de nombreux territoires de reportage et d’écriture. Et à Dubaï où il vit depuis 2012. Auteur, grand reporter, Feurat est né à Paris le 5 décembre 1980, de parents irakiens, exilés. Son père Amir Ahmed Alani était un opposant au régime de Saddam Hussein, et vivre plus longtemps à Bagdad n’était pas une option. Enfant d’un Irak violent et tourmenté, Feurat a grandi à Nanterre, tout près de Paris, dans l’une des 18 tours de la fameuse cité Pablo Picasso. Sa mère y vit encore, et le journaliste était là, en juin dernier, quand les émeutes d’une violence rare ont éclaté, suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer.Aussi va-t-il s’exprimer sur cette tragédie française par un texte publié sur le site Mediapart, qui fera du bruit.
Feurat commence sa carrière en 2003, en découvrant à la télévision les premiers bombardements américains sur l’Irak. Étudiant en journalisme, ces images précipitent son retour à Bagdad, où il réalise ses premiers reportages, en immersion dans sa famille. Il devient correspondant de 2003 à 2008 pour différents titres de la presse francophone internationale. De retour à Paris en 2008, il rejoint Canal+ et les équipes de L’Effet papillon. Il effectue des reportages aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Égypte, en Algérie, en Mauritanie… Très vite producteur indépendant, il retourne dans le «pays des deux fleuves» et réalise un documentaire qui fera date, Irak : Les Enfants sacrifiés de Falloujah. Un témoignage glaçant sur les conséquences de l’utilisation par l’armée américaine de bombes à l’uranium appauvri. Tweets, textes, reportages… L’Irak reste au cœur de son travail. Une quête qui aboutit à la publication d’un roman graphique, Le Parfum d’Irak, honoré par le prix Albert Londres, en 2019. Mais ce chemin des origines n’est pas tout à fait accompli. Son père meurt tout juste avant cette récompense. Feurat reprend sa quête d’écriture. Je me souviens de Falloujah, son premier roman, vient de paraître. Il retrace le parcours de Rami, réfugié politique irakien perdu dans ses souvenirs de jeunesse. Un texte émouvant sur le père, la filiation, les ravages de l’amnésie, le poids de l’histoire et des secrets de famille.
AM: Vos parents sont Irakiens. Et ils ont quitté leur pays pour la France. Quelle est leur histoire d’exil?
Feurat Alani : Mon pèreaquitté l’Irak en 1972 après avoir été incarcéré par le régime. Saddam Hussein était alors en charge de poursuivre les opposants. Le parti Baas au pouvoir ne tolérait aucune opposition ni voix discordante. Mon père était trotskiste, et comme beaucoup de militants, a été arrêté pour activisme. Il a décidé de fuir avec l’espoir de revenir un jour… Ma mère n’était pas militante. D’une famille plus aisée, elle pouvait voyager plus facilement. Fin des années 1970, elle a rendu visite à sa soeur qui résidait en France. Elle y a rencontré mon père et a décidé de rester. La guerre Iran-Irak a éclaté deux ans plus tard.
Vous êtes né en France et vous êtes un enfant de l’exil. Quel impact sur votre propre vie, votre chemin de travail?
Être un enfant d’exilés, en l’occurrence d’Irak, un pays lointain et méconnu, n’ayant pas de passé colonial avec la France (sauf un court moment de l’histoire avec Mossoul, vite concédée aux Britanniques), donne le sentiment d’être en marge parmi ceux en marge. Une sensation étrange d’invisibilité, d’être à côté de la société. Cela a certainement eu une incidence, je crois positive, sur ma manière de voir les choses. D’un point de vue différent sûrement, d’un angle décalé aussi. Être enfant de réfugiés donne certainement l’envie de s’intéresser aux parcours des autres. De raconter son histoire, mais aussi celle de l’altérité.
Votre attachement à cette terre des origines s’exprime par votre prénom Feurat, qui est la version francisée d’Euphrate. D’où vient ce prénom donné par votre père?
Mon père a grandi sur les rives de l’Euphrate, à Falloujah. C’est un fleuve mythique et surtout très important en Irak, en particulier pour les habitants des villes qui le bordent. Mon père a failli se noyer dedans. Puis, après l’avoir apprivoisé, comme les autres garçons de son âge, il a appris à plonger et à y enterrer des pastèques pour les récupérer rafraîchies le soir. Il a noué une relation particulière avec cet endroit, cette source. Peut-être m’a-t-il nommé ainsi pour rester près d’elle et pour ne pas que j’oublie mes origines.
Vous-même, vous revenez en Irak pour y être correspondant de presse, de 2003à2008, lors de l’invasion américaine et de la chute de Saddam Hussein. Quelle est votre lecture de l’histoire irakienne? Cette nation est-elle vouée à la souffrance permanente?
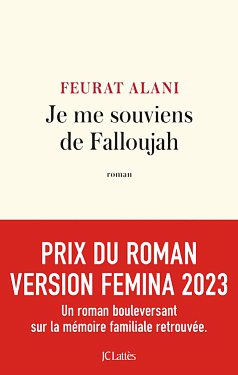
Je n’ai connu l’Irak qu’en guerre. Je suis né en 1980, l’année du déclenchement du conflit avec l’Iran. Depuis ma naissance, l’Irak n’est que synonyme de violence, dictature, invasion… Heureusement, j’ai eu la chance de découvrir ce pays en 1989, la seule année paisible de ces quarante dernières années. Alors, j’ai eu la preuve que non, cette nation n’était pas vouée à la souffrance permanente. Je me suis raccroché à cette année 1989, loin d’être parfaite – c’était toujours une dictature –, mais durant laquelle les gens semblaient avoir une vie normale, qui ressemblait à la nôtre en France. De manière générale, l’histoire irakienne est faite de période de guerre et de paix. L’âge d’or de l’Islam, par exemple, naît à Bagdad. C’est lointain certes, mais je suis optimiste. Un jour, l’Irak vivra en paix.
Vous avez été honoré par le prix Albert Londres en 2019, pour votre roman graphique, Le Parfum d’Irak. Vous y parlez d’un journalisme d’immersion, à hauteur d’homme, un journalisme de la vie aussi. Peut-on encore pratiquer cette presse de proximité à l’époque de la toute-puissance du Web et des réseaux sociaux?
Non seulement on le peut, mais je pense que c’est plus que nécessaire à notre époque digitale. Le journalisme se meurt face à la sur information, aux fake news, à l’intelligence artificielle. Il devient de plus en plus difficile de recouper les bonnes informations et d’exercer cette profession. C’est clairement un défi. Je crois qu’il faut œuvrer pour rendre le journalisme d’immersion plus visible, plus valorisé. L’anecdote autour du Parfum d’Irak est justement la dénonciation de la «sur-rapidité» et du temps court sur les réseaux sociaux. J’ai alors décidé d’écrire le texte de mon premier ouvrage en prenant le temps sur Twitter. La démarche était d’utiliser cet outil pour montrer que l’on pouvait attirer des liseurs curieux, avec un récit au temps long, sur un sujet lointain, à condition d’être sincère, juste et immersif. Il faut aller chercher les lecteurs et lectrices, j’en suis convaincu.

Votre père est décédé en 2019, quelques semaines avant le prix Albert Londres. Et vous venez de faire paraître un roman, Je me souviens de Falloujah, un récit qui évoque le passé récent de l’Irak, mais qui s’appuie surtout sur la vie d’un père, justement, touché par la maladie, comme pour ne pas laisser s’échapper son histoire.
Oui, la démarche première était de refuser l’oubli d’un homme, mon père, mon héros. Je trouve insupportable l’amnésie autour de l’histoire et de la grande histoire. Dans ma DR vie, mon père était un taiseux avec une histoire folle, riche, puissante. Il représente aussi l’exilé qui se sacrifie pour sa famille. C’était un intellectuel qui a fait des boulots de rue en France pour survivre. J’ai voulu lui rendre hommage, tout en racontant un Irak méconnu. Le sien surtout, et le mien, à hauteur d’homme et de femme.
Opposition, admiration, «modélisation»… Nos pères sont-ils à ce point déterminants? Structurants? Et nous mêmes, que se passe-t-il lorsque nous devenons père?
J’en suis persuadé, maintenant que je le suis à mon tour. Au départ, on ne le voit pas. Je me suis construit en opposition par rapport au mien sans me rendre compte, au départ, de tout ce que j’ai pris de lui. Il buvait, je n’ai jamais bu de ma vie. Il fumait, je n’ai jamais fumé. Il militait pour un parti, j’ai choisi d’être journaliste et donc non partisan. Mais aujourd’hui, je prends conscience des valeurs qu’il m’a laissées. L’intégrité, l’honnêteté, la droiture, la loyauté. Se construire en opposition ou en admiration, à mon avis, ne change rien. Ça nous construit malgré nous.

Dans votre documentaire de 2011, Irak: Les Enfants sacrifiés de Falloujah, vous évoquez la bataille dantesque qui s’y est déroulée. Une ville qui, dites-vous, vingt ans après, est toujours dévastée par les effets de la guerre.
Oui, elle a été un laboratoire pour l’armée américaine. Deux batailles en avril et novembre 2004 l’ont rasée. Et les conséquences sur la population sont désastreuses encore aujourd’hui. Des armes toxiques, principalement de l’uranium appauvri et du phosphore blanc, ont été déversées sur la ville, tout cela à l’encontre des conventions internationales. Des bébés déformés naissent tous les jours. Les cancers ont explosé. Une étude indépendante a fait une comparaison avec Hiroshima. Elle conclut que la toxicité à Falloujah est supérieure à celle de la ville japonaise…
Vous avez grandi à la fameuse cité Pablo Picasso, à Nanterre. Vous étiez là-bas pendant les émeutes de fin juin et début juillet, pour rendre visite à votre mère. Et avez publié une tribune dans Mediapart. Comment analysez-vous cette éruption de violence? Que dit-elle de la société française actuelle?
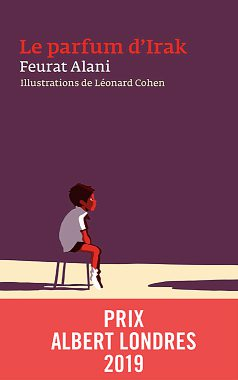
J’ai grandi tout petit à Paris, puis en banlieue, à Argenteuil, et ensuite à Nanterre, où j’ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. Quand on vit dans ces quartiers, quand on y revient, quand ony reste connecté, cette éruption de violence n’est pas une surprise. C’est l’accumulation de beaucoup de choses, une mauvaise gestion politique, sociale, économique de la part des gouvernements français depuis le début des immigrations, mais notamment depuis quarante ans. Le décalage entre la vie dans ces quartiers et celle dans les autres, le sentiment d’avoir été abandonné et d’être en marge (encore une fois) créent une coupure sociale dont il est difficile de se relever. Tous les «plans banlieue» parlent de chiffres mais pas d’humains, de statistiques et non de parcours. La déconnexion avec les forces de l’ordre, vues uniquement comme répressives, notamment depuis la fin de la police de proximité (qui n’est pas la solution miracle non plus), a exacerbé les tensions. Il faut le reconnaître, la société française est fracturée. Ilya plusieurs France.
Comment définissez-vous votre «francitude»? Peut-on être métis, biculturel et françaisàla fois? Comment gérer l’altérité dans un monde qui se referme de plus en plus souvent sur les questions d’identité, d’appartenance, de religion…?
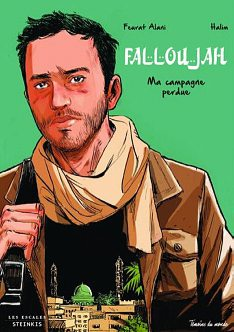
Je n’ai jamais réellement intellectualisé la question avant d’y être confronté dans ma vie. Je vivais très bien le fait d’être français avant que, parfois, on me contredise. Cela m’est arrivé lors de contrôles avec la police ou lors de simples questions curieuses sur mon positionnement en France. Et puis, un jour, j’ai découvert Les Identités meurtrières, d’Amin Malouf, et j’ai lu des choses assez simples et pourtant si compliquées à formuler. Quand on est de double culture comme moi, ce n’est jamais du 50/50. C’est un tout. Je me sens français comme irakien. Citoyen de la République comme musulman. Je crois qu’il faut se concentrer sur le «et», et non pas sur le «ou». Nous ne choisissons pas. Nous sommes.
Que vous reste-t-il de l’Irak, aujourd’hui? Vous vivez à Dubaï, comme pour vous rapprocher toujours un peu plus de ce Moyen-Orient, centre de votre monde et centre du monde…
L’Irak est dans mon cœur. J’ai l’impression de pourchasser ce pays perdu que j’ai cru apercevoir en 1989. En même temps, mon métier m’a amenéàvoyager aux quatre coins de la planète et à m’intéresser aux autres. L’Irak est essentiel dans ma vie, mais il n’est pas mon centre, il est mon point de départ.